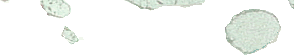Cette roche est un grès rose
La roche est constituée de différents minéraux, en majorité du quartz (95%). L'essentiel du quartz qui constitue les sables est issu du démantèlement de roches magmatiques (surtout le granite), métamorphiques (gneiss ou quartzite par exemple).
Les sédiments résultant de ce démantèlement ont été transportés sur des distances plus ou moins grandes. Les minéraux les plus fragiles ont été progressivement usés et/ou dissous. Les plus résistants de tous, les grains de quartz, sont largement les plus abondants en fin de course. Ces grains de quartz ont ensuite été déposés par gravité. Une fois déposés, ils subissent une diagenèse (transformation de sédiments meubles en roche compacte).
A la fin du Permien, les masses continentales forment un seul continent, la Pangée. La formation de ce super continent a engendré une chaîne de montagne appelée Chaîne Hercynienne. Les conditions climatiques de l'époque sont propices à une érosion intense. Le climat est une succession de saisons chaudes et humides. Le Massif Hercynien « nouvellement » créé est alors érodé, les sédiments sont transportés par des rivières (de type oued). Le dépôt des sédiments se fait lorsque la vitesse du courant devient faible. A la fin du Permien, on est dans une période régressive (de bas niveau marin) favorable à la formation de fleuves permettant ce type de dépôts.
On peut alors penser que la région était parcourue par des rivières ayant des durées de vie plus ou moins longues. Lorsqu'une rivière commence à disparaître, elle dépose les sédiments transportés, les plus gros en premier puis en fonction du ralentissement du régime hydrologique les sédiments de plus en plus fins.
Ensuite un autre bras de rivière vient s'établir par-dessus les sédiments existants et creuse de nouveau son lit, sans faire disparaître totalement les sédiments précédemment déposés. Ce deuxième cours d'eau finit par ralentir et dépose à son tour, au grè des crues, des sédiments issus de l'érosion de la Chaîne Hercynienne.
Cette évolution des rivières conduit à une succession de dépôts de lits millimétriques à centimétriques visibles sur la roche, limités par des niveaux plus sombres qui correspondent aux sédiments les plus fins.
Après le dépôt, les sédiments vont subir une diagenèse, c'est-à-dire un ensemble de modifications qui va transformer les sédiments meubles en roche compacte par cimentation diagénétique.
Il est possible que l'on retrouve des fossiles de végétaux dans le grès, mais ils sont très rares. Le milieu de dépôt est très peu peuplé à cette époque et surtout très érosif. Mais si des tests d'organisme ou des végétaux se déposent, ils se dégradent rapidement sans laisser de traces dans le sédiment, car celui-ci n'est pas adapté à la conservation des restes organiques (milieu oxydant).
La roche a subi une oxydation visible au microscope par un fin liseré brun autour des minéraux. Macroscopiquement cette oxydation se manifeste par la couleur rouge du grès rose (le grès blanc est, quant à lui, beaucoup moins oxydé).
Comme pour tous les terrains anté-Eocène, le grès de la Rhune a subi l'orogenèse pyrénéenne qui a provoqué la surrection de tous ces terrains. C'est ainsi que l'on retrouve aujourd'hui les massifs de grès Permien en altitude (le massif de la Rhune culmine à une altitude de 900 m).
|
Si on voulait résumer l'histoire de cette roche on pourrait le faire de la façon suivante :
Pendant 400 Ma (de –650 à –250 Ma), les continents qui n'avaient pas leur forme actuelle ont dérivé les uns par rapport aux autres. Ils ont fini par entrer en collision provoquant ce que l'on appelle l'orogenèse Hercynienne. La Chaîne Hercynienne était plus grande et plus haute que les Pyrénées actuelles.
Il y a 250 Ma lorsque la chaîne a fini de se mettre en place, le climat était une succession de saisons chaudes sèches et de saisons chaudes et humides, permettant une érosion intense des massifs de cette chaîne. Au fil des saisons, des sédiments sont arrachés du massif. Ces sédiments sont transportés pendant des milliers d'années par des ruisseaux, rivières et autres cours d'eau. Ce transport émousse les grains les rendant plus lisses et mats (on ne trouve pas de particules à bords anguleux), certains composants sont totalement altérés et disparaissent. Lors du dépôt, qui se fait lorsque le courant n'est plus assez fort pour transporter les particules, seul les éléments les plus résistants sont encore présents. C'est ainsi que l'on retrouve une majorité de quartz dans le grès, car c'est un minéral quasi inaltérable. Avec l'accumulation des dépôts, les sédiments s'enfoncent sous leur propre poids. Ils subissent la diagenèse, la circulation de fluide entre les grains permet la précipitation d'un ciment siliceux qui soude les sédiments entre eux. On obtient alors une roche consolidée.
Depuis la fin du Trias, il ne se passe rien d'important pour cette roche. C'est seulement avec l'orogenèse pyrénéenne que son histoire subit un rebondissement. La collision de la plaque ibérique avec la plaque européenne provoque une surrection des terrains. La nouvelle Chaîne Pyrénéenne est alors à son tour soumise aux agents (vent, pluie...) de l'érosion qui altère les terrains et permet aujourd'hui au grès de la Rhune d'être à l'affleurement.
|
|