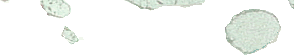Cette roche est un calcaire.
Le calcaire est constitué seulement de calcite, et l'on observe bon nombre de fossiles autant à l'œil nu qu'en lame mince.
On peut donc en déduire que c'est une roche sédimentaire formée par l'accumulation de débris biogènes.
Les fossiles que l'on observe dans ce calcaire sont majoritairement des rudistes.
On trouve aussi des coraux et des mollusques. Les rudistes sont des mollusques bivalves fixés et récifaux qui vivent dans des conditions tropicales et de mers peu profondes.
Ce sont de bons fossiles de faciès car leurs exigences de vie permettent de caractériser un milieu particulier. Ainsi l'on peut dire qu'à l'époque de la formation de ce calcaire, le climat de la région était tropical avec une mer dont la température ne descendait pas en dessous de 18°C.
La zone de vie des rudistes ne dépassait pas 40 m de profondeur. Les rudistes ont vécu au Jurassique et au Crétacé, ce qui implique que la roche s'est formée à cette époque.
L'àge de la roche est donc compris entre 205 et 65 Ma.
Après une étude plus poussée sur la datation de ce calcaire, on peut dire que la roche a été formée pendant l'Aptien (114 à 108 Ma, Crétacé supérieur).
A partir de l'Eocène, on assiste à ce que l'on appelle l'orogenèse pyrénéenne. La plaque ibérique qui remontait vers la plaque européenne, rentre en collision avec cette dernière, entraînant la surrection de tous les terrains déjà en place. C'est pourquoi l'on trouve le massif de calcaire à cette altitude, l'érosion a érodé les terrains qui le surmontaient mettant le calcaire à l'affleurement.
Pendant cette orogenèse, la roche a subi un léger métamorphisme qui a entraîné une petite recristallisation de la calcite (ce qui explique que l'on ait de gros cristaux de calcite).
La tectonique a entraîné une compression qui a formé les fissures ondulées que l'on observe sur la roche ; ces fissures s'appellent des joints stylolithiques (on en trouve dans le calcaire du Jura). Ils forment des lignes qui font penser à des lignes de suture crânienne. La compression qui les a engendrées était perpendiculaire aux axes des fissures.
Après la mise en place de cette roche, des fissures ont pu permettre la circulation de l'eau.
L'eau froide, qui s'est ainsi infiltrée, chargée en CO2, a dissout partiellement la roche calcaire, formant des cavités telles que celles que l'on peut observer aujourd'hui sur l'échantillon qui se trouve sur la pelouse, face à l'entrée du bâtiment « Recherche Géologie » et qui provient de la même carrière.
Il a fallu des milliers d'années pour former cette cavité.
|
Remarque :
Dans les Pyrénées, le calcaire d'Arudy est connu sous le nom de « marbre d'Arudy ». Le terme « marbre » est employé par les carriers pour désigner toute roche calcaire qui peut se polir. Il ne revêt pas nécessairement une connotation métamorphique, comme c'est le cas pour le géologue.
|
|